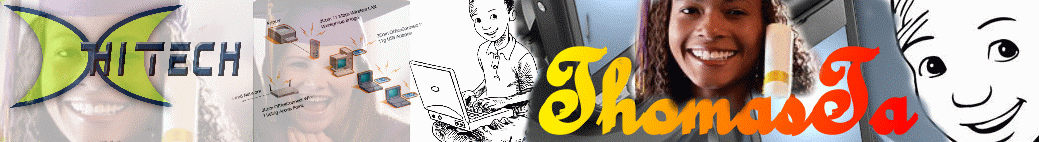 |
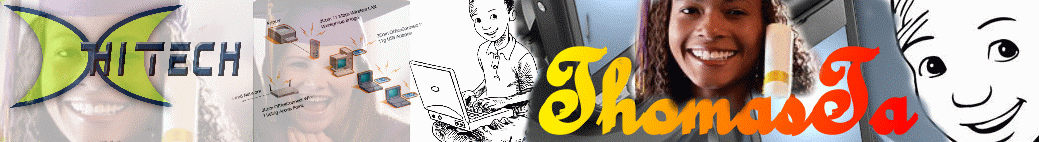 |
Ecrivez-nous
|
Énoncé
et énonciation (1)
Lorsqu'on entre dans une boulangerie et qu'on demande : « Une baguette, s'il vous plaît », on produit un énoncé. Cet énoncé est produit dans une situation particulière que l'on appelle la situation d'énonciation. Comment définit-on une situation d'énonciation ? Tous les énoncés y font-ils référence ? 1. La situation d'énonciation L'énonciation désigne l'acte de s'adresser à quelqu'un par la parole, à l'oral ou à l'écrit. L'énoncé est le résultat de l'énonciation. La situation d'énonciation est la situation concrète dans laquelle l'énoncé est produit. Elle comprend donc les éléments suivants : — les personnes qui se parlent ; on distingue celui qui parle, le locuteur (ou l'émetteur ou l'énonciateur), et celui à qui il s'adresse, l'interlocuteur (ou le récepteur ou l'énonciataire) ; — les autres êtres et les objets présents au moment de l'énonciation, — le lieu et le moment de l'énonciation. Observons cet exemple : « À Madame de Grignan. Aux Rochers, mercredi 13 novembre 1675. Vous êtes étonnée que j'aie un petit chien ; voici l'aventure. » (Madame de Sévigné, Lettres) La situation d'énonciation correspondant à cet énoncé est clairement définie ; on peut répondre aux quatre questions clés : qui parle ? à qui ? où ? quand ? Qui parle ? Madame de Sévigné. À qui ? Madame de Grignan, sa fille. Où ? Dans un lieu appelé les Rochers. Quand ? Le 13 novembre 1675. Remarque : il ne faut pas confondre les notions de phrase et d'énoncé. Une phrase dépend uniquement de la grammaire et non de la situation dans laquelle elle est produite. Imaginons, par exemple que Barnabé aille au cinéma et qu'en sortant de la salle, il dise à son amie Julie : « Ce film était formidable ! » Une semaine plus tard, Julie va au cinéma voir un autre film et s'exclame à son tour : « Ce film était formidable ! » Il s'agit bien de la même phrase mais pas du même énoncé puisque la situation d'énonciation a changé. 2. Les indices d'énonciation Dans certains énoncés, certains mots font référence à des éléments de la situation d'énonciation (personnes, objets, lieu ou moment). Ces mots sont des indices de la situation d'énonciation ; les mêmes mots, dans une autre situation d'énonciation, renverraient à d'autres éléments. Analysons cet exemple : « Ils étaient arrivés avenue Sainte-Foy. Devant l'entrée de l'immeuble, Alexis remercia Thierry de lui avoir fait la conduite. — Cet après-midi, hist'et géo ! bougonna-t-il. Avec ce vieux croûton de Berchu, ce ne sera pas folichon ! Allez, je me grouille ! À tout à l'heure. Mais Thierry ne bougeait pas, un étrange sourire aux lèvres. — Nous avons bien cinq minutes, dit-il. Je peux monter avec toi dans ta chambre ? » (Henri Troyat, Aliocha) Dans les paroles d'Alexis, on relève les indices de la situation d'énonciation suivants : — les pronoms personnels je et me, qui renvoient au locuteur, Alexis ; — le GN cet après-midi et l'adverbe tout à l'heure qui font référence au moment de l'énonciation ; — le présent (grouille) et le futur (sera), qui situent les faits par rapport au moment de l'énonciation. 3. Les deux grands types d'énoncé L'énoncé ancré dans la situation d'énonciation comporte des indices de la situation d'énonciation ; par conséquent, il ne peut être compris que si l'on est au courant de la situation d'énonciation. Ex. : « Je dois vous raconter, cher monsieur, qu'en Palestine où j'étais pour faire le sioniste pendant quelques mois, il y a eu un grand combat où j'ai eu peur et mon sang s'est fait lait caillé et j'ai reçu des balles de fer dans mon organisme mais j'avais une cotte de mailles et une balle a ricoché et m'a occasionné une commotion cérébrale et m'a endormi et ils m'ont cru mort et ils m'ont mis dans une grange ! Et quelques heures plus tard je me mets à éternuer et je m'aperçois de mon erreur ! Et je me rends compte que je ne suis pas mort ! » (Albert Cohen, Mangeclous) Dans cet extrait de roman, on a mis en italique les indices de la situation d'énonciation ; l'énoncé n'est clair que si l'on connaît le locuteur et le moment de l'énonciation auxquels renvoient ces indices. L'énoncé coupé de la situation d'énonciation ne comporte aucun indice de la situation d'énonciation ; par conséquent, il peut être compris indépendamment de la situation d'énonciation. Ex. : « Mangeclous se rendit en Palestine pour défendre la cause sioniste. Au cours d'un combat, il fut touché par une balle mais, heureusement protégé par une 'cotte de mailles' , il en fut quitte pour une belle peur. » (op. cit.) Le résumé du texte précédent sous forme de récit à la 3e personne est un énoncé coupé de la situation d'énonciation. |